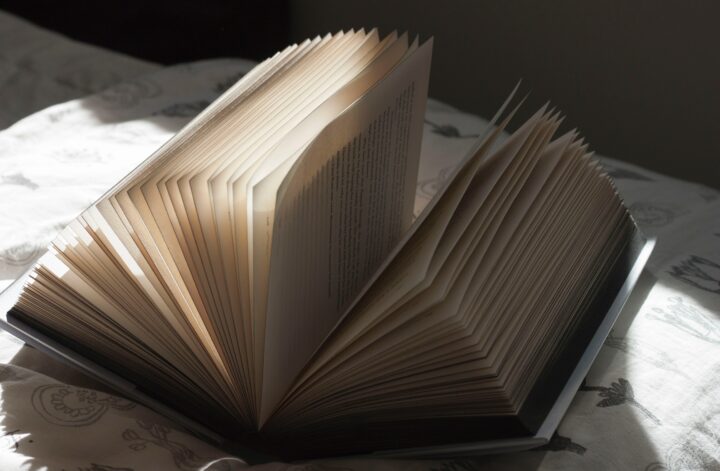J’ai lu ce roman à sa sortie en 1984, j’avais 18 ans. Je découvrais cet immense auteur que je n’ai cessé de lire par la suite.
Pendant que je préparais mon Diplôme Universitaire de Droit Animalier à l’Université de Limoges, notre prof de philo nous a dit que, pour elle, le plus beau roman écrit sur les animaux était « L’insoutenable légèreté… »
Elle n’a pas développé davantage (elle nous enseignait la philo et non la littérature qui n’était pas au programme) et j’ai été interloquée : je n’avais pas le souvenir que ce livre parle des animaux.
Il était resté dans ma mémoire comme un chef d’oeuvre, je me souvenais bien sûr du contexte historique (le printemps de Prague en 1968), des personnages de Tereza et Franz, de ces notions de légèreté et de pesanteur, un vrai point de vue sur la vie, sur l’amour, ce qui fait un bon roman. Et puis un personnage très important aussi, Karénine, le chien. Il est présent, en arrière-plan du récit et j’ai pensé que la prof faisait allusion aux relations des protagonistes avec Karénine.
J’ai relu « L’insoutenable légèreté… »
Comme il est étrange de redécouvrir un livre qu’on a lu dans sa jeunesse. J’ai compris pourquoi j’avais été tellement touchée.
Je ressentais déjà cet amour absolu et inconditionnel pour tous les êtres si différents qui nous entourent. Cet amour qui lie Tereza à Karénine « Meilleur que l’amour qui existe entre elle et Tomas. Meilleur, pas plus grand ». Et, à l’Université de Limoges, lorsque nous nous sommes présentés les uns aux autres, nous avons constaté que ce sentiment existait depuis nos plus anciens souvenirs, chez presque nous tous.
Chacun a pu dire : « Lorsque j’étais enfant, j’étais bouleversé par le sort des animaux…J’étais très attiré par les chiens…les chats…je pleurais devant les films lorsqu’un animal mourait…J’ai toujours su que je m’engagerai pour les aider ». Certains étaient devenus avocats, d’autres vétérinaires, d’autres juristes dans des associations de protection animale. Nous avons vécu pendant deux semaines, tous ensemble, dans l’incroyable douceur de partager ces valeurs de respect de la vie des animaux, cette volonté de faire avancer une cause qui nous tenait à coeur.
J’ai relu le roman de Kundera en rentrant chez moi. J’ai retrouvé ce passage qui me bouleverse :
« J’ai toujours devant les yeux Tereza assise sur une souche, elle caresse la tête de Karénine et songe à la faillite de l’humanité. En même temps, une autre image m’apparaît : Nietzsche sort d’un hôtel de Turin. Il aperçoit devant lui un chevval et un cocher qui le frappe à coups de fouet. Nietzsche s’approche du cheval, il lui prend l’encolure entre les bras sous les yeux du cocher et il éclate en sanglots. Ca se passait en 1889 et Nietzsche s’était déjà éloigné, lui aussi, des hommes. Autrement dit : c’est précisément à ce moment-là que s’est déclarée sa maladie mentale. Mais, selon moi, c’est bien là ce qui donne à son geste sa profonde signification. Nietzsche était venu demander pardon au cheval pour Descartes. Sa folie (donc son divorce d’avec l’humanité) commence à l’instant où il pleure sur le cheval. Et c’est ce Nietzsche-là que j’aime, de même que j’aime Tereza, qui caresse sur ses genoux la tête d’un chien mortellement malade. Je les vois tous les deux côte à côte : ils s’écartent tous deux de la route où l’humanité, « maître et possesseur de la nature », poursuit sa marche en avant. »
Je me suis demandé à quel moment, moi, je m’étais écartée de cette route.
Il y a bien longtemps sans doute, avec d’autres qui sont nés avec cet horrible don de voir la souffrance chez tous les êtres, ceux que j’ai rencontrés à Limoges, ceux qui se battent pour sauver des animaux dans des associations, au Parti Animaliste, au quotidien, chacun à leur niveau et avec leurs forces. Ceux qui ont cette bonté.
Ce que Kundera énonce ainsi : « La vraie bonté de l’homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu’à l’égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de l’humanité, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci : les animaux. Et c’est ici que s’est produite la faillite fondamentale de l’homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent »
Et Kundera a écrit ces lignes en 1984. Que dirions-nous maintenant plus de trente ans plus tard ? L’humanité inflige toujours plus de souffrance aux animaux, l’élevage intensif n’a cessé de se développer, aucune des pratiques barbares (corrida, exploitation pour les loisirs, pratiques de chasses les plus cruelles…) à l’encontre des animaux n’a disparu de notre monde.
Serons-nous un jour plus nombreux à suivre un autre chemin ?
Lisez ou relisez l’insoutenable légèreté de l’être…